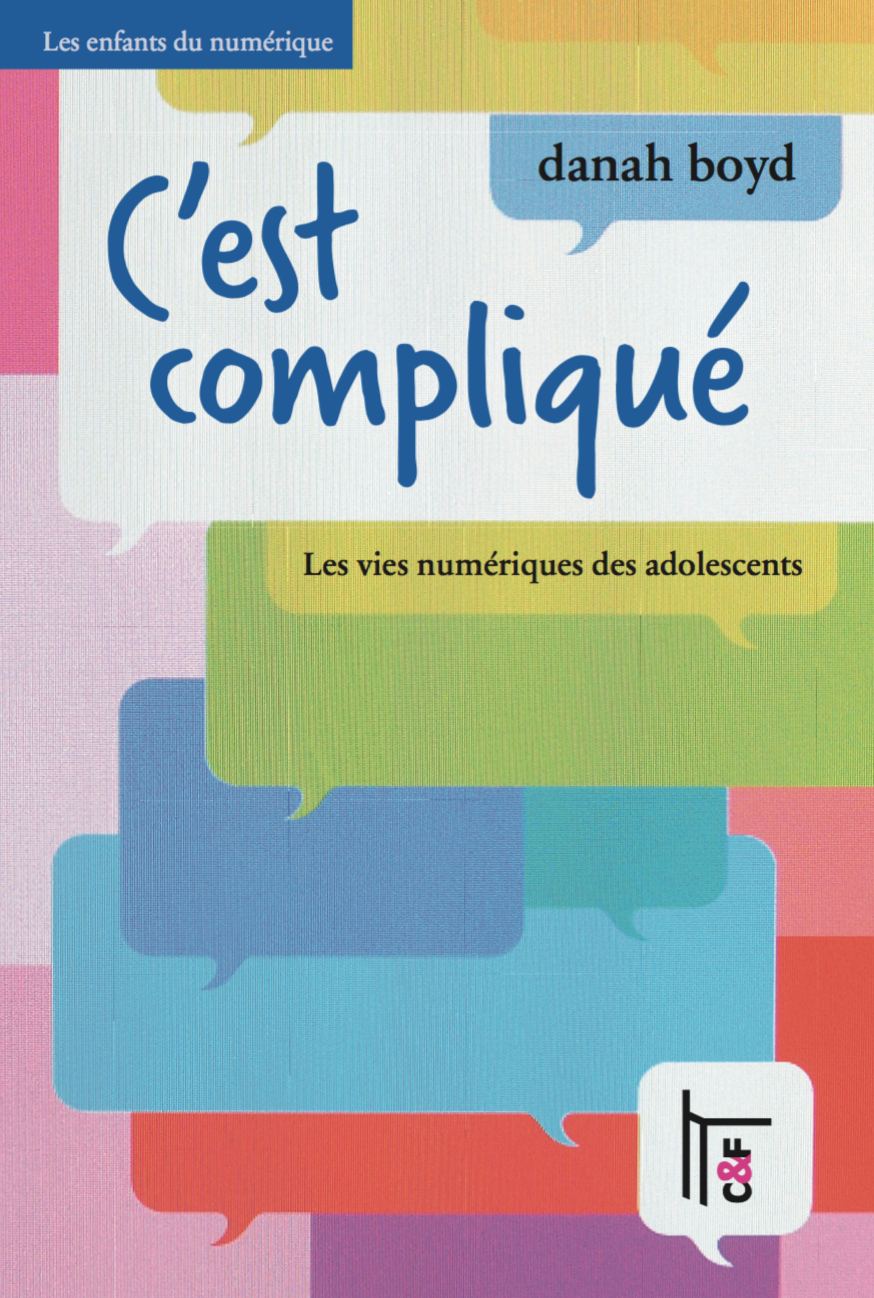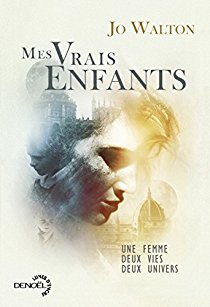J'ai fait connaissance de danah boyd
grâce à la très regrettée émission de Xavier de la Porte Place
de la toile. Tout de suite, j'ai
aimé son approche des problèmes : écouter d'abord, analyser
ensuite, expliquer enfin dans un langage simple des réalités
complexes. Sociologue
chez Microsoft et professeure
à la New York University,
ellemène ses enquêtes de terrain comme une ethnologue. Son
domaine de recherche, ce sont les rapports des gens avec les
technologies numériques. Notre
bonheur, c'est qu'elle restitue le fruit de ses recherches dans des
livres passionnants comme un bon roman.
Les
éditions C&F ont eu la très bonne idée de traduire le plus
connu de ses livres qui s'intitule C'est compliqué.
Il traite, comme le souligne le sous-titre, de la vie numérique des
adolescents, américains bien sûr puisque le terrain de chasse de
danah boyd est le territoire des États-Unis.
On y parle donc des ados et de leurs terminaux informatiques, mais
pas seulement. On y parle surtout de la place de la jeunesse dans la
société. Et ce n'est pas si simple.
Depuis
Françoise Dolto, on sait que l'adolescent·e
est un cactus fragile : ça pique, ça mord, mais ça ne sait pas
trop où se mettre et comment
se définir par rapport aux autres.
Pour les parents c'est un casse-tête : c'est trop jeune mais ce
n'est plus un bébé non plus. Trouver un équilibre, c'est
compliqué. Et c'est là que la guéguerre commence. Pour les
adolescent·e·s,
le numérique est un outil formidable pour conquérir l'espace
public, se forger une vie sociale, mais aussi délimiter leur vie
privée. Ce qui est compliqué, c'est que tout cela se construit avec
des exigences contradictoires, et des obstacles posés par les
parents qui protègent, voire surprotègent leurs enfants.
danah boyd approche la question d'un
point de vue spatial très intéressant. Elle souligne combien les
adolescent·e·s américain·e·s sont souvent subtilement
enfermé·e·s et ne peuvent plus sortir en dehors des chemins très
balisés par les parents, mais aussi par les nombreuses contraintes
dues aux inégalités sociales et raciales. Pour ces ados, l'espace
virtuel remplace l'espace physique de rencontre, parce que ce dernier
n'est plus disponible.
Elle montre aussi que les inégalités
sociales et raciales se retrouvent sur les réseaux sociaux comme
dans l'espace physique, avec l'utilisation de certaines applications
plus que d'autres dans certaines communautés, et des ségrégations
fortes sans même parfois que les utilisateur·trices (ados et
adultes confondus) s'en rendent compte !
Elle montre enfin que les peurs des
parents liées à Internet ne sont que le reflet d'un malaise général
de la société américaine qui amplifie les peurs diverses au point
de refuser une émancipation graduelle des jeunes, alors que beaucoup
de ces angoisses sont amplifiées et déformées, sans aucune mesure
avec la réalité.
Ce tableau de la société américaine
vue du clavier des adolescent·e·s ne reflète pas tout à fait les
sociétés européennes, mais les thèmes abordés sont les mêmes
là-bas et ici. Les pratiques peuvent varier, les applications
évoluer au gré des nouveaux outils proposés ou des modes, selon
les pays, mais les aspirations des ados et les peurs des parents
demeurent.
danah boyd plaide pour un
accompagnement des jeunes sur les voies informatiques comme on
apprend aux enfants à parcourir la ville et les espaces physiques
qui les entourent. Sur Internet, la frontière entre espace public et
privé est floue, parce que cette frontière est floue dans la tête
des adolescents. Elle plaide aussi pour une littératie (litteracy),
un apprentissage de l'Internet sous deux angles complémentaires :
les algorithmes et le code d'une part, la construction du savoir
d'autre part. Elle plaide pour une confiance raisonnée dans nos
adolescent·e·s.
Ce
livre est rafraichissant par bien des aspects, rassurant sur
l'adolescence en général, mais pose les enjeux d'une éducation au
monde numérique. C'est une réflexion salutaire sur les modalités
et les enjeux de cette éducation. Pour qui s'intéresse un peu à la
question, il ouvre de nombreuses réflexions non seulement sur les
adolescent·e·s,
mais sur nos propres pratiques, en tant que parents, enseignant·e·s
ou mêmes dans nos propres
utilisations quotidiennes.
Sommes-nous si différent·e·s
de ces ados qui se construisent un réseau social, non seulement sur
la toile, mais aussi dans la vraie vie ?
Décidément
nos relations au numériques sont comme les relations amoureuses des
jeunes,
du moins si on en croit le statut massivement indiqué sur leur page
Facebook : C'est compliqué...